OMS : les inégalités sociales dans tous les pays influent sur la mortalité
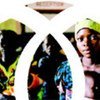
Les inégalités sociales, y compris dans les pays développés, ont une influence directe sur la mortalité, affirme un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié jeudi, qui établit un lien fréquent, mais pas exclusif, entre la pauvreté et la vulnérabilité.
« Un enfant né dans une banlieue de Glasgow, en Écosse, aura une espérance de vie inférieure de 28 ans à un autre né à peine treize kilomètres plus loin. L'espérance de vie à la naissance d'une fille au Lesotho est inférieure de 42 ans à celle d'une autre née au même moment au Japon. En Suède, le risque pour une femme de décéder pendant une grossesse ou lors d'un accouchement est de 1 pour 17 400, alors qu'en Afghanistan il est de 1 pour 8 », tels sont les exemples cités dans un nouveau rapport issu d'une enquête de trois ans menée par des responsables politiques, universitaires, anciens chefs d'État et ministres de la santé, regroupés au sein de la Commission des déterminants sociaux de l'OMS.
La Commission impute ces inégalités à un ensemble de principes, de politiques et de mesures économiques « peu judicieuses ». Le rapport intitulé « Combler le fossé en une génération: instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé » conclut que «l'injustice sociale tue à grande échelle.»
Pour les membres de la Commission, l'amélioration du sort des femmes serait la première à prendre pour apporter une amélioration considérable à la santé et à l'espérance de vie de milliards d'êtres humains.
Les inégalités sanitaires ont depuis longtemps été mesurées entre les pays, mais la Commission met l'accent sur les «écarts sanitaires» existant à l'intérieur des frontières nationales.
Ainsi, l'espérance de vie chez les hommes autochtones australiens est inférieure de 17 ans à celle des autres hommes en Australie. La mortalité maternelle est 3 à 4 fois plus forte chez les pauvres que chez les riches en Indonésie. La mortalité de l'adulte est 2,5 fois plus importante dans les quartiers les plus démunis que dans les quartiers les plus favorisés au Royaume-Uni. La mortalité infantile dans les bidonvilles de Nairobi est 2,5 fois plus importante que dans les autres parties de la ville. Aux États-Unis, 886.202 décès auraient été évités entre 1991 et 2000 si le taux de mortalité avait été le même chez les Américains d'origine africaine que chez les Blancs, alors qu'à titre de comparaison seules 176.633 vies ont pu être sauvées grâce aux progrès de la médecine au cours de la même période.
La richesse à elle seule ne détermine pas l'état de santé d'une population. Certains pays à faible revenu comme Cuba, le Costa Rica, la Chine, l'Etat du Kerala en Inde et le Sri Lanka ont atteint des niveaux de santé satisfaisants malgré un revenu national relativement peu élevé.
Les pays nordiques, par exemple, ont suivi des politiques qui encouragent l'égalité en matière d'avantages et de services, le plein emploi, la parité entre les sexes et de faibles niveaux d'exclusion sociale.
La Commission recommande de centrer la lutte contre les problèmes sanitaires non pas sur la médication ou les soins mais sur les conditions et les modes de vie. Elle souligne que les maladies d'origine hydrique ne sont pas causées par un manque d'antibiotiques mais par l'eau contaminée et par l'incapacité des forces politiques, sociales et économiques de fournir de l'eau potable à tous; les cardiopathies sont causées non par une insuffisance d'unités de soins coronariens, mais par le mode de vie conditionné par l'environnement dans lequel on vit.
