Liberté de la presse : 150 journalistes ont trouvé la mort en 2006
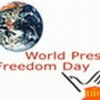
« Les pays en conflit sont les plus dangereux pour les journalistes, et l'année dernière n'a pas fait exception », a dit Louise Arbour dans un communiqué publié le 1er mai et transmis aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2007.
Mais les journalistes sont aussi tués, harcelés et intimidés par les autorités, des groupes armés ou le crime organisé dans des pays qui sont censés être en paix, a fait observer la Haut Commissaire.
« Qu'ils soient en guerre ou non, les pays les plus dangereux pour les médias ont un point commun : ils manquent pratiquement tous à l'obligation de traduire en justice les auteurs de ces attaques et de ces meurtres », a-t-elle déploré.
Selon un communiqué de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) publié aujourd'hui à Paris, « environ 580 journalistes dans le monde sont morts dans l'exercice de leur fonction entre janvier 1992 et août 2006 ».
Citant le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), l'UNESCO estime que « 71,4% de ceux-ci ont été assassinés, 18,4% sont morts lors d'échanges de tirs ou dans des circonstances liées à des combats et 10% au cours d'autres missions dangereuses ».
Les journalistes de la presse écrite sont les plus exposés au danger de mort, affirme l'agence des Nations Unies, qui souligne que « 85% des meurtres de journalistes au cours des 15 dernières années n'ont pas donné lieu à des enquêtes ou des poursuites judiciaires. Dans seulement 7% des cas ayant fait l'objet d'enquête, de poursuites et de condamnations, les commanditaires ont été traînés devant les tribunaux ».
Lors d'une conférence de presse donnée hier au siège de l'ONU à New York, les directeurs du CPJ affirmaient que « deux pays d'Afrique subsaharienne, l'Éthiopie et la Gambie, figurent en tête de la liste des États où la liberté de la presse s'est le plus détériorée ces cinq dernières années ».
Robert Mahoney, Directeur adjoint du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), était venu présenter aux côtés de Joël Campagna, Coordonnateur du Programme Moyen-Orient du CPJ, les conclusions d'une étude mondiale conduite par cette organisation.
Selon le rapport du CPJ, la Gambie et la République démocratique du Congo sont, avec la Fédération de Russie et Cuba, les pays les plus répressifs en matière de liberté de la presse.
Selon les informations contenues dans le rapport, deux journalistes ont été assassinés en RDC au cours des deux dernières années et 11 sont en prison.
« En Gambie, Deyda Hydara, l'éditeur de l'un des principaux journaux, a été assassiné et 11 journalistes ont été jetés en prison au cours de la seule année 2006. Quant à l'Éthiopie, le CPJ y a découvert l'emprisonnement de 18 journalistes ».
L'Afrique n'est pas seule au palmarès des violations graves contre la liberté d'informer. Au Pakistan, révèle le rapport du CPJ, huit journalistes ont été tués au cours des cinq dernières années. Quinze autres sont portés disparus au cours de la même période. En Azerbaidjan, au cours des cinq dernières années, un éditeur a été assassiné, tandis que 9 journalistes étaient jetés derrière les barreaux et que 2 de leurs collègues étaient kidnappés.
Le CPJ a cependant exclu de son rapport les grandes zones de conflit comme l'Iraq et la Somalie, qui souffrent d'une absence de structures conventionnelles de gouvernance ou de collecte d'information.
Les pays suivants figurent, par ordre de classement, sur la liste établie par le CPJ: République démocratique du Congo (RDC), Cuba, Pakistan, Égypte, Azerbaïdjan, Maroc et Thaïlande.
Le fait que cinq pays d'Afrique, tous salués à un moment donné pour s'être engagés sur la voie de la transition démocratique, se trouvent parmi eux, révèle la fragilité de ce processus quand il s'agit de respecter la liberté de la presse, souligne le Directeur exécutif du CPJ, Joël Simon.
En réponse à une question, M. Mahoney a souligné que cette liste n'était pas forcément celle des pays où la situation de la presse est la plus préoccupante, comme c'est par exemple le cas au Zimbabwe, mais qu'elle cite les pays où cette liberté s'est le plus dégradée au cours de ces cinq dernières années.
L'Iraq et la Somalie devraient faire l'objet de rapports séparés, a expliqué M. Mahoney, non seulement en raison de l'extrême gravité des formes de violences qui y sont perpétrées, mais aussi du fait de l'absence de réelle gouvernance dans ces pays et de la difficulté d'y réunir des informations fiables.
Il est également ardu d'enquêter sur ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique populaire de Corée (RPDC) ou au Myanmar, a-t-il ajouté.
« En publiant un tel rapport, qui jette le discrédit sur certains États, nous espérons une réaction des gouvernements concernés », a déclaré Robert Mahoney, en soulignant que l'objet du CPJ était de pointer les dysfonctionnements observés dans les pays uniquement sur la base des normes internationalement acceptées et reconnues en matière de liberté de la presse. 85% de gens coupables d'assassinats de journalistes courent toujours, a-t-il rappelé.
M. Mahoney a indiqué que si dans certains pays figurant dans la liste, comme le Maroc ou l'Égypte, on constatait que la censure s'était assouplie au fil des années, permettant ainsi à une presse de plus en plus indépendante de s'épanouir, on y notait aussi que des représailles étaient exercées contre des éditeurs ou des journalistes jugés trop critiques à l'égard des régimes en place.
Au Maroc, par exemple, les médias d'État ont pris pour cible les publications indépendantes qui avaient couvert l'affaire des caricatures du Prophète Mahomet. Certains journalistes se sont estimés gravement menacés du fait des attaques des médias officiels, a indiqué M. Mahoney. Généralement considéré comme un modèle dans sa région en ce qui concerne le respect des droits de la presse, le Maroc partage pourtant avec la Tunisie le triste record du plus grand nombre de cas d'emprisonnements de journalistes dans le monde arabe, a fait observer M. Campagna.
Répondant à une question de la presse, M. Mahoney a indiqué que, même si la liberté de la presse n'y était jamais entièrement respectée, aucun pays occidental ne figurait dans le classement, dans la mesure où ces pays ne remplissaient pas les critères et le niveau de violations retenus pour établir la liste.
Au sujet des enlèvements de journalistes, les représentants du CPJ ont déclaré qu'ils comprenaient la réaction des familles qui se disent prêtes à payer une rançon pour obtenir la libération d'un des leurs. Ils ont cependant attiré l'attention sur le fait que le paiement d'une rançon pouvait représenter un danger pour les autres journalistes travaillant dans la région concernée, puisque la tentation de les enlever à leur tour pouvait alors devenir beaucoup plus grande.
Dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour garantir la protection des journalistes à travers le monde entier, les représentants du Comité ont révélé qu'ils s'étaient entretenus, la semaine dernière, avec le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui les a assurés du soutien de l'ONU dans cette lutte (dépêche du 3.05.2007).
